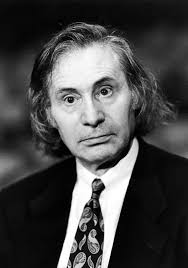Touchante histoire que celle de Teculihuatzin, princesse maya du Mexique du XVIème siècle, la Reine Indienne : par amour, mais sans doute aussi par calcul politique, elle se convertit au catholicisme et prend alors le nom de Doña Luisa en devenant l’épouse du chef militaire Don Pedro de Alvarado dont elle attend qu’il l’intègre à la culture espagnole qu’elle juge supérieure à la sienne.
Se rendant ainsi complice de l’œuvre de conquête des troupes commandées par son époux, elle espère pouvoir atténuer la barbarie impitoyable des traitements infligés à son peuple.
Mais aucune de ses sincères espérances, amoureuse ou politique, ne connaîtra mieux que la trahison.
There’s joy in my grief and there’s freedom in chains.

Émouvante Reine Indienne !
Héroïne de l’opéra que Purcell laisse inachevé à sa mort en 1695 et que Peter Sellars, metteur en scène de génie, fait remonter sur les tréteaux 320 années plus tard, pour lui offrir une histoire bien moins sucrée que celle proposée par le livret initial, le revisitant profondément et le modernisant. Complétant la partition originale du Maître anglais par d’autres mélodies empruntées à d’autres œuvres de sa composition, et clairsemant l’opéra nouveau de larges citations d’une romancière nicaraguayenne de notre temps.
Il « automne » beau dans le cœur saturnien de cette Indian Queen qui prend les traits et la voix de Julia Bullock.
Acte III – Scène 8 (Teculihuatzin/Dona Luisa : chez le chaman)
« I attempt from love’s sickness to fly in vain »
(Je tente en vain d’échapper aux maux de l’amour…)
Acte IV – Scène 2 (Dona Luisa & Chœurs)
« They tell us that your mighty powers above »
(On nous dit que vous, puissants pouvoirs célestes…)
On nous dit que vous, puissants pouvoirs célestes,
Savez rendre parfaits vos joies et vos plaisirs par l’amour.
Ah ! Comment pouvez-vous accepter les délices d’en haut
Et infliger au pauvre amoureux de tels tourments ici-bas ?
Et pourtant, bien que je souffre tant pour ma passion
Mon amour restera, comme le vôtre, constant et pur.
Souffrir pour lui apaise mes tourments ;
Il y a de la joie dans mon chagrin, et de la liberté dans mes chaînes.
Même si j’étais d’essence divine, il ne pourrait m’aimer davantage,
Et moi, en retour, j’adore mon adorateur.
Ô, de sa chère vie, dieux cléments, prenez donc soin,
Car je n’ai pas d’autre part à votre bénédiction.
They tell us that your mighty powers above
Make perfect your joys and your blessings by Love.
Ah! Why do you suffer the blessing that’s there
To give a poor lover such sad torments here?
.
Yet though for my passion such grief I endure,
My love shall like yours still be constant and pure.
To suffer for him gives an ease to my pains
There’s joy in my grief and there’s freedom in chains;
.
If I were divine he could love me no more
And I in return my adorer adore
O let his dear life the, kind Gods, be your care
For I in your blessings have no other share.
Cette Indian Queen singulière possède une indéniable puissance d'esprit et de manière, croisant les continents et les époques presque à la façon de Terra nostra de Fuentes. La partition inachevée de Purcell (1695), composée d'après la pièce de Sir Robert Howard et John Dryden (1664), se mêle à des extraits déclamés de "La Niña blanca y los pájaros sin pies" de la romancière nicaraguayenne Rosario Aguilar (1992). La Restauration anglaise de 1660, qui ré-ouvrait les théâtres après leur interdiction par le Puritain Cromwell, rencontre ainsi le récit de la Conquista et interroge ces « Indes » dont les saveurs avaient pénétré Londres mais cachaient derrière leur exotisme la fin d'un monde. Sellars vous invite donc à une nouvelle histoire bien différente de l'aimable fantaisie imaginée par Dryden : une partition enrichie d'autres pages de Purcell, une expérience scénique où les souples chorégraphies de Christopher Williams habitent les fresques fauves de l'artiste de rue chicano Gronk, couleurs jaillissantes et totémiques qui semblent braver un demi-millénaire d'impérialisme politique, culturel et intellectuel, jusqu'à un finale rouge sang - auquel fera écho la chemise de Sellars lors de saluts joyeux. Extrait de l'article de Chantal Cazaux publié le 11/03/2016 dans Avant Scène Opéra
Et quelques mots de Peter Sellars lui-même (en anglais) :