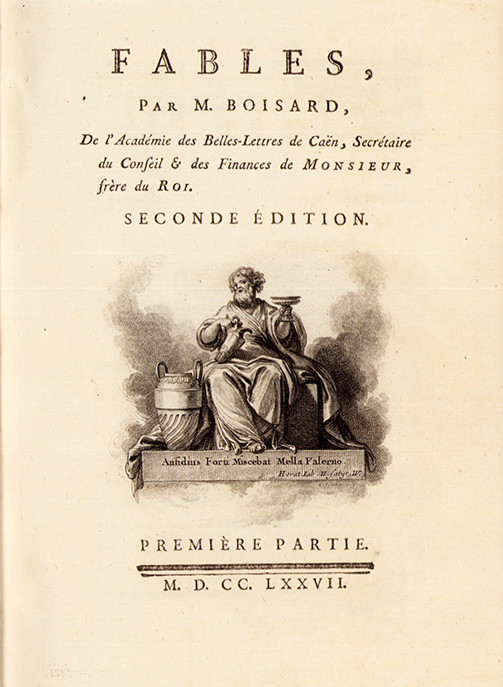« Éva », un poème d’Achille Chavée, figure emblématique du surréalisme belge de la première moitié du XXème siècle, qui révèle le regard passionné et non conventionnel que porte son auteur sur l’image de la femme. Moins un idéal qu’une force tellurique et morale indomptable, capable à la fois de détruire et de créer : la femme, aventure suprême de l’homme.
Éva
Femme ténébreuse
errante de la mauvaise vertu
errante du bien pour le mal
adroite et décidément maladroite
parmi les rideaux de rêve et de soie
parmi les pains de chaleur de chair et de sang
parmi l’homme dépaysé d’être lui-même
femme dangereuse
légèrement inclinée
dans le vent des miracles
légèrement vêtue dans le vent du péché
légèrement perdue dans l’ouragan de vie
femme qui joues
femme qui ris
femme qui pleures
femme qui veux gagner toujours
une chance en plus que le cœur trouvé
dressée à nous ravir
à joindre notre défaillance
à ne jamais nous oublier
à ne jamais nous délivrer
à nous aimer l’éternité de ses mensonges
femme dressée à se livrer
dans l’ombre d’une science exacte
dans la nuit de notre souffrance
dans l’oubli de notre mission
femme impardonnable et pardonnée
voilà que c’est moi le maudit
qui se prend à te reconnaître
à défendre tes cris de malheur
à redramatiser l’aube de ta passion
à pardonner le sang que tu révèles
à s’attendrir sur ton ventre de vie
à t’aimer plus qu’un désert de diamant
ô femme qui jamais ne me pardonneras

Achille Chavée 1906-1969
in « D’ombre et de sang » (1946)