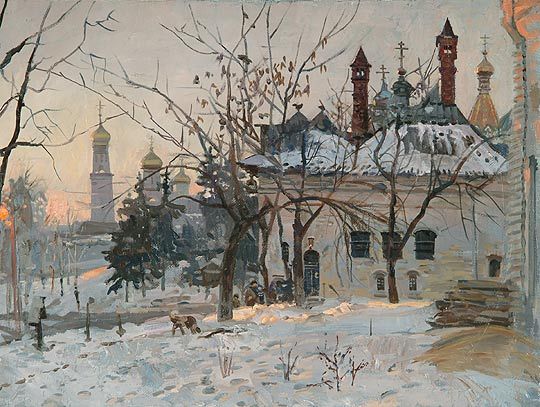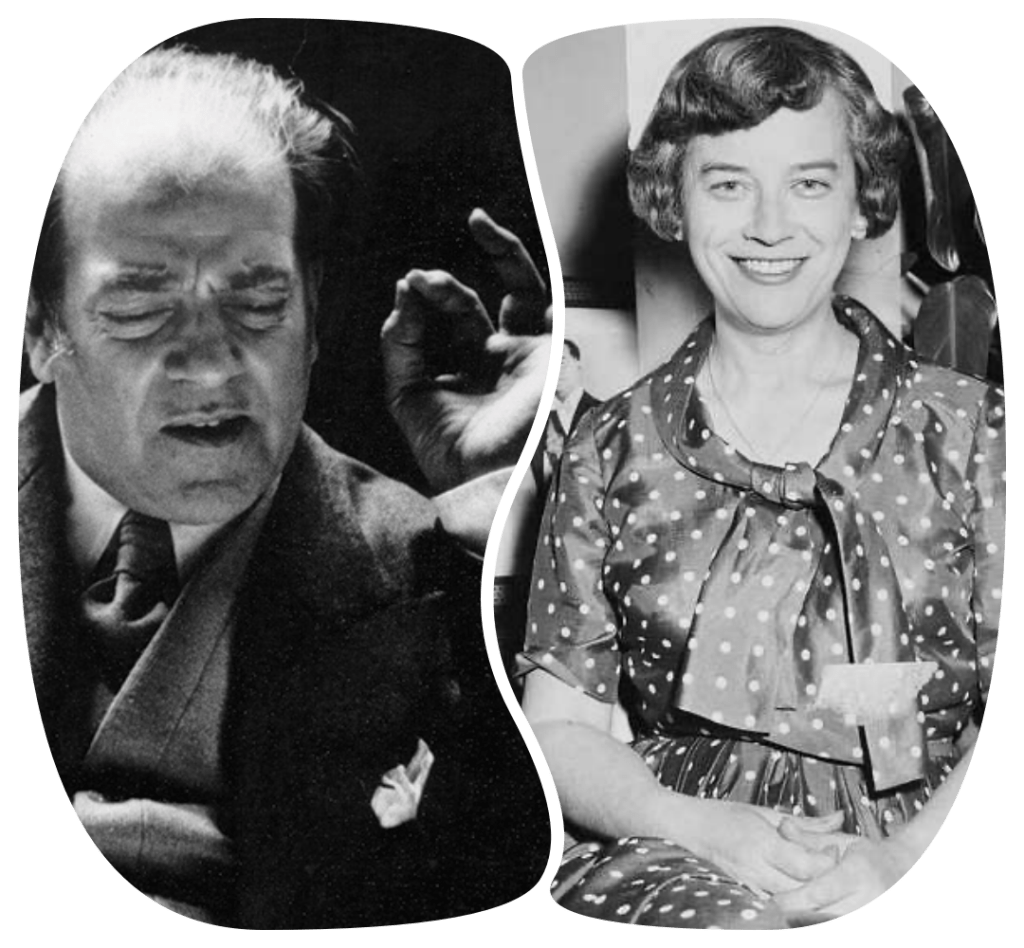
Heitor Villa-Lobos 1887-1959
&
Dora Vasconcellos 1910-1973
Partagée entre lyrisme et nostalgie, « Melodia sentimental » est sans doute l’une des pièces les plus célèbres du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos.
Elle fait partie d’une suite orchestrale destinée en 1959 au cinéma hollywoodien, mais la partition se trouvera grandement sacrifiée au montage. Villa-Lobos lui redonnera une place de choix dans l’œuvre de concert en laquelle il convertira sa musique de film.
« Melodia sentimental » est une sérénade traditionnelle brésilienne qui naturellement fait la part belle au sentiment amoureux, mais qui flatte également la beauté de la nature.
La ‘saudade’, ce sentiment typiquement brésilien qui mêle mélancolie, nostalgie et espoir s’infiltre harmonieusement à travers les modulations de la musique. C’est dans l’interprétation voix-piano ou voix-guitare, sur les paroles de la poétesse brésilienne, diplomate et grande amie du compositeur, Dora Vasconcellos, que le charme atteint à son paroxysme.
– En version ‘lyrique’ grâce, par exemple à la soprano Roberta Mameli accompagnée au piano par Olaf Laneri
Réveille-toi, viens voir la lune
Qui dort dans la nuit noire
Qui brille si belle et blanche
Déversant sa douceur
Claire flamme silencieuse
Brûlant mes rêves
Les ailes de la nuit qui surgissent
Parcourent l’espace profond
Oh, douce bien-aimée, réveille-toi
Viens apporter ta chaleur au clair de lune
Je voudrais te savoir mienne
Dans ce moment serein et calme
L’ombre confie au vent
La limite de l’attente
Quand dans la nuit
Elle réclame ton amour
Réveille-toi, viens regarder la lune
Qui brille dans la nuit noire
Chérie, tu es belle et douce
Sens mon amour et rêve.
– En version plus populaire par l’émouvante Mônica Salmaso accompagnée à la guitare par Luis Leite